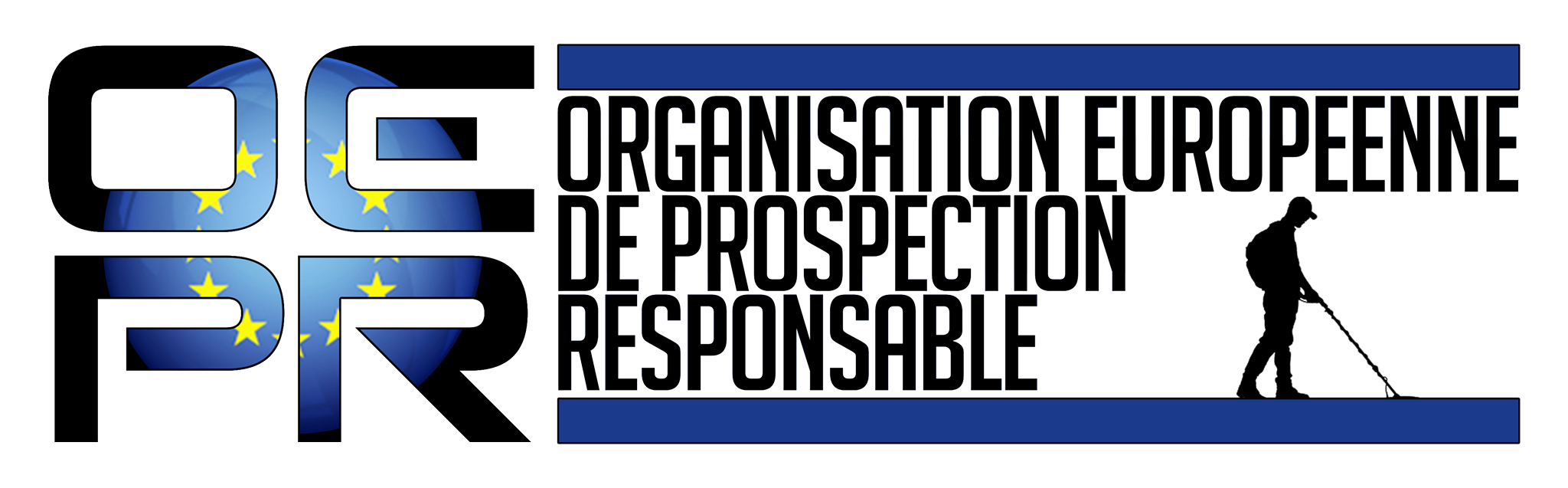Résumé
La conservation du patrimoine archéologique français est depuis plusieurs décennies gravement menacée par les utilisateurs de détecteurs de métaux. Pour endiguer ce fléau qui porte atteinte à la recherche et à la conservation des vestiges, l’État met en œuvre des actions pédagogiques et répressives .
Abstract
The conservation of France’s archaeological heritage has been seriously threatened for several decades by users of metal detectors. To curb this scourge, which undermines research and conservation of the remains, the State implements educational and repressive measures.
Cet texte est issu d’une communication présentée lors du colloque « Archéo-Éthique », accessible en français et en anglais.
Le pillage des sites archéologiques par la prospection avec un détecteur de métaux est devenu en France une question centrale pour la politique publique patrimoniale. Cette problématique de la détection de métaux a été traitée dès 1981 par le Conseil de l’Europe [1] estimant notamment que « ce problème ne constitue qu’un aspect d’une conception générale erronée des principes de l’archéologie et de la nature du patrimoine archéologique ». Régulièrement des archéologues français, parfois associés à des juristes [2-8] ont publié des contributions dans des revues nationales et internationale [9] pour alerter, à de rares exceptions près [10], sur cette problématique et ses conséquences pour la recherche archéologique.
Le 22 juin 1989, le sénateur Michel Miroudot présente au Sénat un rapport sur le sujet de la détection en vue de l’adoption d’une loi spécifique. Il indique après avoir rappelé que le patrimoine est « une réserve culturelle finie » notamment que « les utilisateurs de détecteurs de métaux sont animés par une volonté de découvertes d’objets métalliques en vue de leur possession – l’objectif est alors la constitution d’une collection personnelle – ou de l’approvisionnement du marché des objets d’antiquités – le mobile est alors le profit » [11].
En 2011, un rapport élaboré par le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) revient sur ce sujet [12]. Ce rapport ne retient pas comme solution alternative les systèmes mis en place au Danemark (le Danefæ), en Angleterre et aux Pays de Galles (Treasure Act), mais propose plutôt un renforcement du cadre juridique au motif que le patrimoine est « un bien culturel fragile et non renouvelable ». L’idée d’une licence pour les possesseurs d’un détecteur avec timbre fiscal est d’emblée écartée par le Conseil national. Parmi les propositions formulées, celle d’une immatriculation et d’un enregistrement des détecteurs de métaux qui, associée à l’autorisation préfectorale, aurait pour effet de mieux contrôler cette activité. Très vite les associations de détectoristes ont fait connaître leur opposition à ces principes en publiant des réponses au texte du CNRA. C’est le cas par exemple de l’association Vive la détection sous le titre « revendications » ou de Détect + qui soutient la position du Fédération Européenne des Prospecteurs, que : « le vrai défi est d’associer plutôt que d’exclure et de rechercher les conditions d’une collaboration pérenne entre les prospecteurs et les utilisateurs de détecteurs de métaux [UDM] et les archéologues de terrain surtout d’éviter une fracture définitive entre deux mondes qui sont en réalité bien complémentaire » [13]. Quant à la Fédération Nationale des Utilisateurs de Détecteurs de Métaux (FNUDEM), elle présente dans un texte publié sur son site en 2013, pour éviter « les dérives actuelles et les conflits destructifs », une dizaine de propositions et suggère de regrouper les utilisateurs d’un détecteur de métaux dans une seule fédération pour permettre à l’État d’avoir un interlocuteur unique [14].
En réalité, cette prise de position, par la plus haute instance archéologique consultative représentative de la communauté scientifique nationale, s’inscrit dans la logique de la loi du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux qui stipule dans son article premier que « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la Préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu l’autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que la nature et les modalités de la recherche » [15]. Avec cette loi, la France a anticipé un principe qui est inscrit dans la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique [16], dite « convention de Malte » ratifiée par la France en 1994 dont l’article 3 indique que les États membres du Conseil de l’Europe et les autres États partis à cette convention sont convenus de soumettre à une autorisation préalable spécifique l’emploi de détecteurs de métaux et autres équipements de détection ou procédés pour la recherche archéologique. Cette décision, à l’instar des prospections et des fouilles, nécessite pour le territoire national que le prospecteur réalise les démarches obligatoires en application de la loi du 27 septembre 1941 [17] portant réglementation des fouilles archéologiques avant tout engagement sur le terrain, afin d’obtenir une autorisation administrative délivrée par les services de l’État, ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente. Cette autorisation doit être fondée sur un projet scientifique cohérent mené par des personnes pouvant justifier des compétences techniques et scientifiques adaptées. Ce principe général est, à nouveau, confirmé en 2004 dans le code du patrimoine dont Delestre 2019 Page 159 l’article L. 542-1 [18]1 reprend mot pour mot l’article premier de la loi de 1989 pour éviter que les adeptes de la « détection dite à présent de loisir », pratiqué en dehors de tout cadre scientifique, n’accélèrent l’érosion du patrimoine archéologique et prive « les concitoyens et les générations futures de sources inédites nécessaires à la connaissance du passé des territoires » comme le souligne la ministre de la Culture en réponse, le 12 juillet 2016, à l’Assemblée nationale à un parlementaire [19].
L’adoption le 7 juillet 2016 de la loi relative à la liberté de création [20], à l’architecture et au patrimoine mettra à terme selon les articles L. 541- 4 à 6 un coup d’arrêt au commerce des objets archéologiques suite aux précisions apportées quant au régime de propriété de ce que l’on nomme désormais les « biens archéologiques »2. Ainsi les polémiques liées à des ventes aux enchères, comme celle que nous avons connue en avril 2019 à propos d’un lot d’objets découverts en 2012 à Tavers (Loiret) par des détectoristes, ne pourront plus se reproduire. Cet ensemble comprenait soixante-cinq objets protohistoriques qui, compte tenu de l’intérêt patrimonial et scientifique, avaient été déclarés par le ministère de la Culture « trésor national » empêchant ainsi la sortie des objets du territoire du français. Il était proposé à la vente au prix de 50 000 euros. La presse écrite et orale régionale et nationale a largement couvert cette affaire, à lire par exemple dans le quotidien le Figaro du 25 avril 2019 l’article intitulé « Levée de boucliers avant la vente aux enchères d’un trésor gaulois » [21]. Elle a donné lieu également à de nombreux échanges sur les réseaux sociaux. Des plaintes ont été déposées par l’association Halte au pillage d’une part et d’autre part par les commissaires-priseurs. Finalement, les objets ont été acquis quelques heures avant la vente, après une entente gré à gré, entre le vendeur et le musée national d’archéologie de Saint-Germain-en-Laye au montant de la mise à prix. Pour l’heure, malgré la consolidation du droit en la matière [22] et des prises de position quasi unanimes des archéologues français, force est de constater une aggravation de ce phénomène qui met en péril la bonne conservation des archives du sol. Les commentaires laissés sur les réseaux sociaux et sur les forums en apportent clairement la preuve au travers de la présentation régulière de découvertes faites lors de sorties réalisées de jour ou de nuit seul ou en groupe.
Dans ce contexte où les démarches et les actions pédagogiques (figure 1) initiées par l’État ne suffisent pas, il est nécessaire de recourir à des mesures répressives.
La conservation du patrimoine archéologique français est depuis plusieurs décennies gravement menacée par les utilisateurs de détecteurs de métaux. Pour endiguer ce fléau qui porte atteinte à la recherche et à la conservation des vestiges, l’État met en œuvre des actions pédagogiques et répressives .
Abstract
The conservation of France’s archaeological heritage has been seriously threatened for several decades by users of metal detectors. To curb this scourge, which undermines research and conservation of the remains, the State implements educational and repressive measures.
Cet texte est issu d’une communication présentée lors du colloque « Archéo-Éthique », accessible en français et en anglais.
Le pillage des sites archéologiques par la prospection avec un détecteur de métaux est devenu en France une question centrale pour la politique publique patrimoniale. Cette problématique de la détection de métaux a été traitée dès 1981 par le Conseil de l’Europe [1] estimant notamment que « ce problème ne constitue qu’un aspect d’une conception générale erronée des principes de l’archéologie et de la nature du patrimoine archéologique ». Régulièrement des archéologues français, parfois associés à des juristes [2-8] ont publié des contributions dans des revues nationales et internationale [9] pour alerter, à de rares exceptions près [10], sur cette problématique et ses conséquences pour la recherche archéologique.
Le 22 juin 1989, le sénateur Michel Miroudot présente au Sénat un rapport sur le sujet de la détection en vue de l’adoption d’une loi spécifique. Il indique après avoir rappelé que le patrimoine est « une réserve culturelle finie » notamment que « les utilisateurs de détecteurs de métaux sont animés par une volonté de découvertes d’objets métalliques en vue de leur possession – l’objectif est alors la constitution d’une collection personnelle – ou de l’approvisionnement du marché des objets d’antiquités – le mobile est alors le profit » [11].
En 2011, un rapport élaboré par le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) revient sur ce sujet [12]. Ce rapport ne retient pas comme solution alternative les systèmes mis en place au Danemark (le Danefæ), en Angleterre et aux Pays de Galles (Treasure Act), mais propose plutôt un renforcement du cadre juridique au motif que le patrimoine est « un bien culturel fragile et non renouvelable ». L’idée d’une licence pour les possesseurs d’un détecteur avec timbre fiscal est d’emblée écartée par le Conseil national. Parmi les propositions formulées, celle d’une immatriculation et d’un enregistrement des détecteurs de métaux qui, associée à l’autorisation préfectorale, aurait pour effet de mieux contrôler cette activité. Très vite les associations de détectoristes ont fait connaître leur opposition à ces principes en publiant des réponses au texte du CNRA. C’est le cas par exemple de l’association Vive la détection sous le titre « revendications » ou de Détect + qui soutient la position du Fédération Européenne des Prospecteurs, que : « le vrai défi est d’associer plutôt que d’exclure et de rechercher les conditions d’une collaboration pérenne entre les prospecteurs et les utilisateurs de détecteurs de métaux [UDM] et les archéologues de terrain surtout d’éviter une fracture définitive entre deux mondes qui sont en réalité bien complémentaire » [13]. Quant à la Fédération Nationale des Utilisateurs de Détecteurs de Métaux (FNUDEM), elle présente dans un texte publié sur son site en 2013, pour éviter « les dérives actuelles et les conflits destructifs », une dizaine de propositions et suggère de regrouper les utilisateurs d’un détecteur de métaux dans une seule fédération pour permettre à l’État d’avoir un interlocuteur unique [14].
En réalité, cette prise de position, par la plus haute instance archéologique consultative représentative de la communauté scientifique nationale, s’inscrit dans la logique de la loi du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux qui stipule dans son article premier que « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la Préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu l’autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que la nature et les modalités de la recherche » [15]. Avec cette loi, la France a anticipé un principe qui est inscrit dans la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique [16], dite « convention de Malte » ratifiée par la France en 1994 dont l’article 3 indique que les États membres du Conseil de l’Europe et les autres États partis à cette convention sont convenus de soumettre à une autorisation préalable spécifique l’emploi de détecteurs de métaux et autres équipements de détection ou procédés pour la recherche archéologique. Cette décision, à l’instar des prospections et des fouilles, nécessite pour le territoire national que le prospecteur réalise les démarches obligatoires en application de la loi du 27 septembre 1941 [17] portant réglementation des fouilles archéologiques avant tout engagement sur le terrain, afin d’obtenir une autorisation administrative délivrée par les services de l’État, ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente. Cette autorisation doit être fondée sur un projet scientifique cohérent mené par des personnes pouvant justifier des compétences techniques et scientifiques adaptées. Ce principe général est, à nouveau, confirmé en 2004 dans le code du patrimoine dont Delestre 2019 Page 159 l’article L. 542-1 [18]1 reprend mot pour mot l’article premier de la loi de 1989 pour éviter que les adeptes de la « détection dite à présent de loisir », pratiqué en dehors de tout cadre scientifique, n’accélèrent l’érosion du patrimoine archéologique et prive « les concitoyens et les générations futures de sources inédites nécessaires à la connaissance du passé des territoires » comme le souligne la ministre de la Culture en réponse, le 12 juillet 2016, à l’Assemblée nationale à un parlementaire [19].
L’adoption le 7 juillet 2016 de la loi relative à la liberté de création [20], à l’architecture et au patrimoine mettra à terme selon les articles L. 541- 4 à 6 un coup d’arrêt au commerce des objets archéologiques suite aux précisions apportées quant au régime de propriété de ce que l’on nomme désormais les « biens archéologiques »2. Ainsi les polémiques liées à des ventes aux enchères, comme celle que nous avons connue en avril 2019 à propos d’un lot d’objets découverts en 2012 à Tavers (Loiret) par des détectoristes, ne pourront plus se reproduire. Cet ensemble comprenait soixante-cinq objets protohistoriques qui, compte tenu de l’intérêt patrimonial et scientifique, avaient été déclarés par le ministère de la Culture « trésor national » empêchant ainsi la sortie des objets du territoire du français. Il était proposé à la vente au prix de 50 000 euros. La presse écrite et orale régionale et nationale a largement couvert cette affaire, à lire par exemple dans le quotidien le Figaro du 25 avril 2019 l’article intitulé « Levée de boucliers avant la vente aux enchères d’un trésor gaulois » [21]. Elle a donné lieu également à de nombreux échanges sur les réseaux sociaux. Des plaintes ont été déposées par l’association Halte au pillage d’une part et d’autre part par les commissaires-priseurs. Finalement, les objets ont été acquis quelques heures avant la vente, après une entente gré à gré, entre le vendeur et le musée national d’archéologie de Saint-Germain-en-Laye au montant de la mise à prix. Pour l’heure, malgré la consolidation du droit en la matière [22] et des prises de position quasi unanimes des archéologues français, force est de constater une aggravation de ce phénomène qui met en péril la bonne conservation des archives du sol. Les commentaires laissés sur les réseaux sociaux et sur les forums en apportent clairement la preuve au travers de la présentation régulière de découvertes faites lors de sorties réalisées de jour ou de nuit seul ou en groupe.
Dans ce contexte où les démarches et les actions pédagogiques (figure 1) initiées par l’État ne suffisent pas, il est nécessaire de recourir à des mesures répressives.